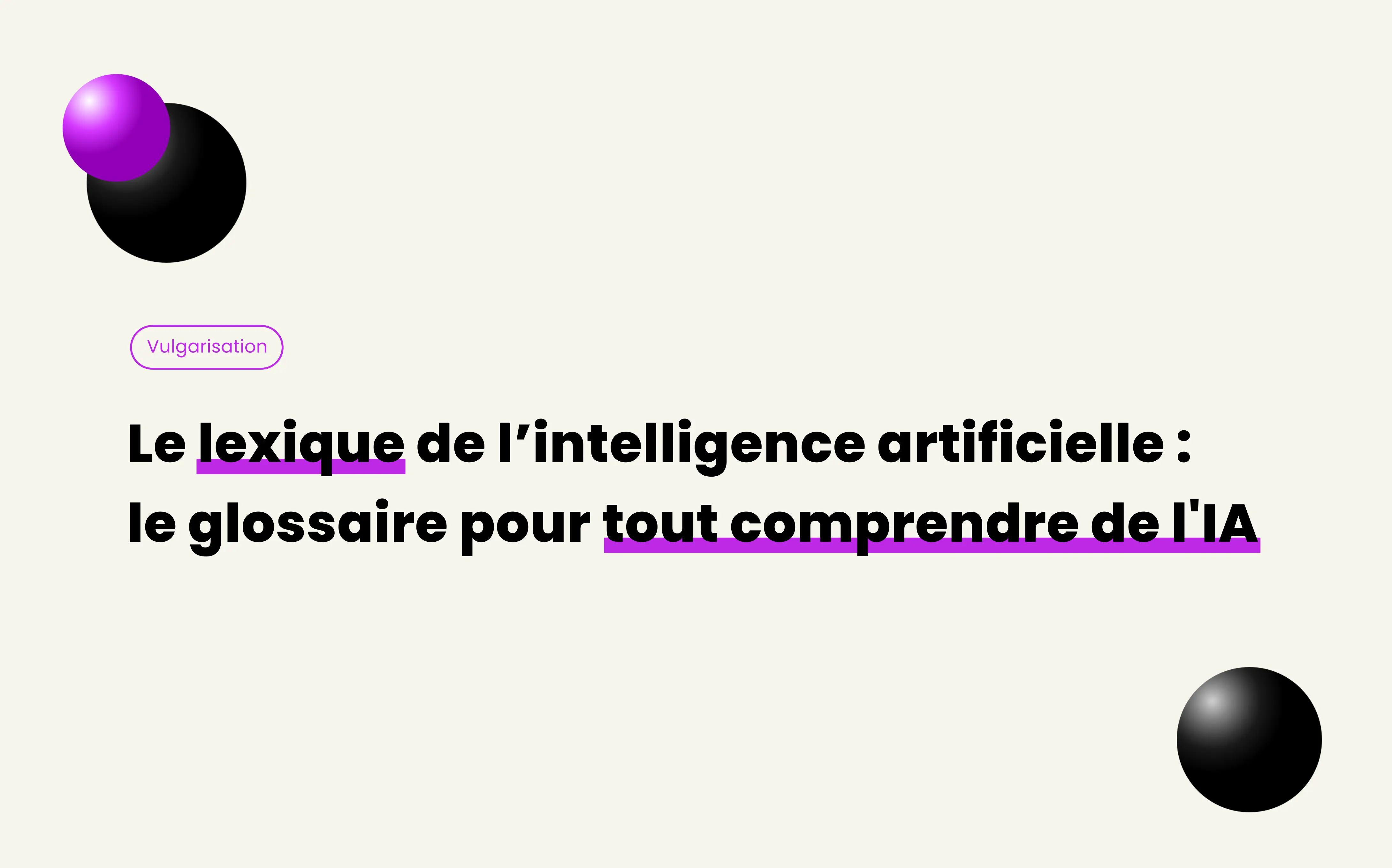
Chez Micelia, notre ambition est de démystifier l’IA pour qu’elle soit compréhensible par tous.
Voici un glossaire complet, reprenant les principaux concepts utilisés par les experts et la littérature spécialisée, avec des explications simples et imagées.
Techniques visant à tromper un modèle en introduisant des données malveillantes ou ambiguës lors de l’entraînement, pour le rendre plus robuste ou l’induire en erreur.
Règlement européen encadrant le développement, l'utilisation et la commercialisation de systèmes d'intelligence artificielle. Il classe les systèmes en niveaux de risques (minimal, limité, élevé, interdit) et impose des obligations en conséquence (transparence, supervision humaine, etc.).
Suite d’instructions permettant de traiter des données et produire un résultat. Comparable à une recette permettant de transformer les ingrédients en plat fini.
Étiquetage manuel, semi-automatique voire automatique, de données (par ex. une image de chien avec son label indiquant qu'elle représente un chien). Utilisé en phase d’apprentissage supervisé comme vérité terrain.
Méthode semi-supervisée où l’opérateur sélectionne des exemples pour annoter, afin d’optimiser l’entraînement.
Méthode d’intelligence artificielle qui permet d'apprendre des règles à partir des données, sans programmation explicite.
Approche de machine learning où le modèle apprend à partir de données non étiquetées en créant lui-même des pseudo-labels.
Approche de machine learning où le modèle apprend à partir de données non étiquetées, sans supervision humaine.
Approche de machine learning où le modèle apprend par essai/erreur avec une récompense associée à un objectif, comme un joueur apprenant une stratégie gagnante.
L'apprentissage profond utilise des réseaux neuronaux artificiels formant de nombreuses couches pour résoudre des tâches complexes. Très utile face à de grands volumes de données.
Approche de machine learning où le modèle où l'algorithme s'entraîne à une tâche déterminée en utilisant un jeu de données étiquetées.
Utilisation d’un modèle déjà entraîné sur une tâche pour l'adapter à une autre avec peu de données.
Un système qui s’améliore en intégrant de nouvelles tâches oun données après son déploiement, sans perdre les apprentissages passés (learning en production).
Le Bagging, ou Bootstrap Aggregating, est une technique d’assemblage (ensemble learning) puissante et polyvalente. Au lieu de se fier à un seul modèle, le Bagging exploite la sagesse de la foule en créant de multiples versions d’un même modèle, chacune entraînée sur un sous-ensemble différent de données d’entraînement. Random Forest est l’exemple le plus connu.
Une base de données est un ensemble d'informations structurées et organisées de manière à être facilement accessibles, gérées et mises à jour. C’est un élément essentiel à tout projet IA.
Un batch est un lot de données. La taille du batch correspond au nombre de données qui sont "montrées" à l'algorithme avant que les poids/paramètres du modèle soient recalculés.
Une des techniques de régularisation les plus puissantes en Deep Learning pour faciliter le processus d’apprentissage. La normalisation par lots vise à accélérer l’apprentissage et améliorer la stabilité de l’entraînement.
Les méthodes bayésiennes sont des méthodes d’inférence statistique qui consistent à attribuer une probabilité aux hypothèses, puis à mettre à jour ces probabilités en fonction des observations, selon le théorème de Bayes.
Distorsion statistique dans les données ou les modèles, qui entraîne des résultats partiaux ou injustes. Exemple : un modèle de recrutement entraîné sur des données historiques biaisées peut favoriser un genre ou une origine.
Ensemble de fonctions et d’outils prêts à l’emploi permettant de créer, entraîner ou déployer des modèles IA. Exemples : TensorFlow, PyTorch, scikit-learn.
Données numériques massives caractérisées par leur volume, leur vélocité et leur variété. Elles sont notamment utilisées pour entraîner et généraliser les modèles d’IA.
Rectangle délimitant un objet détecté dans une image. Utilisé en vision par ordinateur pour la détection d’objets. Par exemple : encadrer une voiture dans une image de rue.
Technique d’apprentissage séquentielle qui combine des apprenants faibles pour former un modèle fort, chaque itération corrigeant les erreurs des précédentes afin d’améliorer la précision.
Aussi appelé agent conversationnel, il s’agit d’un logiciel qui vise à simuler le dialogue en langage naturel avec un utilisateur. Certains reposent sur des arbres décisionnels classiques quand d’autres s’appuient sur de grands modèles de langage.
ChatGPT est un agent conversationnel, communément appelé chatbot, développé par OpenAI et lancé le 30 Novembre 2022. Il se base sur les différentes versions du modèle GPT (ajourd'hui GPT-5).
Morceau ou segment de données, souvent utilisé dans les modèles LLM pour découper les documents en parties plus petites à traiter (ex : chunk de 512 tokens).
Tâche consistant à assigner une étiquette ou catégorie à une donnée (ex. spam ou non spam pour un e-mail).
Modèle ou algorithme chargé d’effectuer la classification. Ex : un modèle SVM ou un arbre de décision sont des classificateurs.
Il s’agit d’une méthode permettant de diviser un ensemble de données en différents sous-ensembles homogènes, partageant des caractéristiques communes, des clusters.
Réseau de neurones convolutifs en français. Un Convolutional Neural Network (CNN) est une architecture spécifique de réseaux de neurones utilisée en Deep Learning notamment.
Système qui traduit des instructions écrites en langage de haut niveau, comme celles de PyTorch ou TensorFlow, en langage machine, ou code, GPU ou CPU hautement efficace.
Puissance de calcul nécessaire à l’entraînement ou l’inférence (CPU, GPU, TPU). Mesurée en FLOPS, elle impacte performance et coût.
Domaine applicatif de l'IA concernant l'extraction d'informations depuis des images ou vidéos : détection et reconnaissance d’objets, visages, etc.
L'ingénierie contextuelle consiste à construire l'intégralité des informations accessibles pour un LLM : pas seulement un prompt, mais toutes les données, exemples et conseils pertinents nécessaires à la tâche.
L'apprentissage contrastif en français. C’est une technique d'apprentissage automatique qui apprend aux modèles à distinguer des échantillons différents tout en regroupant les éléments similaires sans que les données ne soient étiquetées.
Opération mathématique utilisée dans les réseaux de neurones convolutifs (CNN), principalement pour l’analyse d’images. Elle permet d’extraire des motifs comme les contours, textures, etc.
Comme ChatGPT, Copilot est un chatbot basé sur un grand modèle de langage (LLM). Il est développé par Microsoft et a été lancé le 7 février 2023.
La courbe ROC est une représentation visuelle des performances du modèle pour différents seuils de décision.
Le CPU (Central Processing Unit), autrement dit unité centrale de traitement ou processeur, il est l’une des pièces les plus importantes d’un ordinateur. En effet, il va permettre d’effectuer les échanges entre tous les composants d’un PC.
Méthode qui sert à tester la performance des modèles sur l'ensemble des données par échantillonnage successif des données d'entraînement et de validation.
Matière première de l’IA : ce sont les informations (textes, images, chiffres, sons…) utilisées pour entraîner, tester ou prédire avec un modèle.
Techniques d’enrichissement de jeu de données (ex. rotation, bruit, transformation) pour améliorer la généralisation des modèles.
Discipline s’axant sur la structuration des flux de données. Elle consiste à les collecter, les stocker et les organiser pour mieux les traiter de manière appropriée et optimale.
Fouille de données, extraction automatique de connaissances à partir de grands ensembles de données.
Discipline consistant à traiter des données brutes pour les transformer en informations lisibles et exploitables pour de l’IA.
Science des données, discipline englobant l’analyse et la valorisation des données par l’IA.
Ensemble structuré de données (images, texte, transactions) utilisé pour entraîner ou évaluer un modèle IA.
Base de données en français. Système de stockage et de gestion de données, souvent plus complexe et dynamique. Une base de données peut comporter de nombreux datasets différents.
Contenus audio/vidéo générés par IA imitant de façon réaliste une personne existante, souvent à des fins trompeuses.
Sous-catégorie du Machine Learning utilisant de très grands réseaux de neurones multicouches pour extraire des représentations complexes.
Approche avancée en intelligence artificielle qui combine des modèles de langage (LLM) avec des capacités de raisonnement sur plusieurs étapes pour résoudre des problèmes complexes ou répondre à des questions multi-niveaux.
Exemple : plutôt que de répondre directement à "Quel est le lien entre la Révolution industrielle et l’intelligence artificielle ?", un système de deep search va explorer des sous-questions intermédiaires, construire une chaîne logique, et fournir une réponse riche et cohérente.
Tâche de repérer la présence et la position d’un objet dans une image. Elle s’accompagne souvent d’une bounding box. Exemple : détecter tous les piétons dans une image de rue.
Algorithme d’optimisation qui ajuste les paramètres d’un modèle en suivant la direction opposée au gradient pour minimiser une fonction de coût.
Un modèle de diffusion est un modèle génératif qui apprend à créer des données nouvelles en inversant un processus de bruit progressif.
La distillation des connaissances est une méthode d’optimisation de modèle où un modèle complexe (“teacher”) transfère son savoir à un modèle plus petit (“student”). L’idée est de réduire la taille, le coût de calcul et la latence tout en conservant les performances du modèle original.
L'encodage de caractéristiques est une technique utilisée en apprentissage automatique pour convertir des données brutes en un format exploitable par les algorithmes.
L'encodeur est le premier bloc d'un auto-encodeur, un type d’architecture de réseau de neurones conçu pour compresser efficacement (encoder) les données d’entrée vers leurs caractéristiques essentielles, puis reconstruire (décoder) l’entrée d’origine à partir de cette représentation compressée.
Exécution d’algorithmes d’IA directement sur des appareils périphériques (IoT, mobile), réduisant latence et préservant la confidentialité.
Les embeddings sont des représentation vectorielle, et donc des représentations numériques, de données comme du textes des images ou des vidéos dans un espace d'embedding et qui capturent les relations entre les entrées.
Processus d’apprentissage d’un modèle à partir de données. Il consiste à ajuster ses paramètres internes (poids) pour qu’il minimise l’erreur sur un ensemble d’exemples connus.
Système centralisant et stockant de grands volumes de données provenant de diverses sources pour en faciliter l'analyse et l'exploitation.
L’Epoch (époque) désigne le nombre de fois où l’entièreté des données d’entraînement ont été observées par le modèle.
Processus visant à comprendre et valider la fiabilité de tout modèle d'IA, en s'appuyant sur les résultats obtenus en introduisant l'ensemble de données de test dans le modèle et en le comparant aux réponses réelles.
Capacité à comprendre et justifier les décisions d’un système d’IA. Cela inclut savoir pourquoi un modèle a pris telle ou telle décision, essentiel pour la confiance, la conformité et l’éthique.
L’extraction de caractéristiques est l'étape au cours de laquelle sont induites depuis des données brutes (son, image, texte, tableau numérique, etc.) des caractéristiques sur lesquelles le système d’IA doit se reposer pour effectuer la tâche pour laquelle il est conçu.
Les faux négatifs désignent l'incapacité d'un système IA à détecter un événement spécifique qu'il était censé détecter. Le modèle IA n’a rien détecté alors qu’il aurait dû le faire.
La fausse détection, également appelée « faux positif », fait référence à une forme d’hallucination des modèles d’IA. Cela correspond à la détection d’un événement inexistant.
Caractéristique en français. Descripteur utilisé par un modèle pour faire des prédictions. Ex : pour prédire le prix d’un bien immobilier, les features peuvent être la surface, la localisation, le nombre de pièces…
Capacité d’un modèle à apprendre à partir d’un petit nombre d’exemples, 3 à 5 maximum, lui permettant de généraliser plus facilement. C’est une alternative plus légère que le fine-tuning, et très utilisée avec les LLMs.
Affinage d’un modèle pré-entraîné sur un nouveau jeu de données spécifique, pour adapter ses performances à un cas d’usage particulier. Exemple : affiner GPT pour comprendre un jargon métier ou un détecteur à détecter des objets bien spécifiques.
Fonction mathématique appliquée à un signal en sortie d'un neurone artificiel déterminant s’il s’active selon certaines conditions.
Loss function en anglais, et également appelée fonction de coût. Elle mesure l’écart entre les prédictions du modèle et la réalité. Elle guide l’apprentissage.
Ensemble d’outils, de bibliothèques et de bonnes pratiques structurées pour créer et déployer des systèmes IA. Les frameworks accélèrent le développement, assurent la reproductibilité et facilitent le passage de la recherche à la production. Exemples célèbres : TensorFlow, PyTorch, Hugging Face Transformers...
Modèle génératif composé de deux réseaux (générateur vs discriminant) en compétition, capable de générer des données de synthèses comme des images ou des sons réalistes.
Une gaussienne est une distribution de probabilité caractérisée par une moyenne (valeur centrale) et un écart-type (dispersion autour de la moyenne). Elle est représentée par une courbe en cloche.
Branche de l’IA regroupant des famille de modèles capables de créer des contenus originaux (texte, image, vidéo, son…) à partir d’un prompt ou d’une instruction.
Capacité d’un modèle à bien fonctionner sur des données nouvelles, jamais vues pendant l'entraînement.
La génération de données vise à produire des données de synthèses imitant les propriétés statistiques des données réelles. Elle est souvent utilisé pour améliorer certains modèles en leur fournissant des données rares/inexistantes. Modèle génératif composé de deux réseaux (générateur vs discriminant) en compétition, capable de générer des données de synthèses comme des images ou des sons réalistes.
Un GPU est un processeur spécialisé conçu pour effectuer des calculs massivement parallèles, particulièrement adapté au traitement graphique et à l’accélération de tâches intensives comme l’apprentissage profond.
Modèle de langage basé sur des transformers et entraîné de manière auto-supervisée pour prédire le prochain token. Il est ainsi capable de générer du texte cohérent à partir d’un contexte donné.
Un gradient est une information mathématique qui indique comment et dans quelle direction ajuster les paramètres d’un modèle afin d’améliorer ses performances. Le gradient mesure la variation de l’erreur d’un modèle (fonction de perte) par rapport à chacun de ses paramètres.
Structure de données qui permet de représenter des connaissances sous forme de relations entre des entités. Un graphe est composé de noeuds représentant des entités et des arrêtes représentant les relations.
Modèle d’intelligence artificielle conçu pour apprendre à partir de données structurées sous forme de graphes. Il apprend en faisant circuler l’information à travers le graphe, chaque nœud mettant à jour sa représentation en fonction de ses voisins.
Ensemble de méthodes algorithmiques utilisées en intelligence artificielle pour explorer un graphe afin de trouver un chemin, une solution ou un état optimal.
Phénomène où un modèle d’IA générative génère des informations a priori plausibles mais incorrectes ou non fondées sur les données.
Concept statistique qui désigne une situation où la variabilité d’une variable n’est pas constante selon le niveau d’une autre variable.
Par exemple :
Revenus faibles → dépenses assez proches les unes des autres
Revenus élevés → dépenses très variables
Méthode pratique de résolution de problème qui ne garantit pas toujours la meilleure solution, mais permet d’en trouver une rapidement et efficacement. En d’autres termes, il s’agit d’une règle approximative, souvent basée sur l’expérience ou l’intuition.
Organisation des concepts selon des relations de généralisation/spécialisation (ex. : animal → mammifère → chien).
HITL pour les intimes, et “humain dans la boucle” pour les francophones. Approche mixte où l’humain intervient pour guider, corriger ou valider les décisions de l’IA.
Paramètre choisi avant l’apprentissage (ex. taux d’apprentissage, époque, taille du batch...) qui impacte les performances et le comportement du modèle.
Principe selon lequel les mots ayant des contextes similaires ont des sens proches.
Recherche automatique des meilleurs hyperparamètres via méthode (grid search, Bayesian optimization).
Systèmes conçus pour une tâche spécifique, sans intelligence générale ou conscience.
Intelligence artificielle générale hypothétique, comparable à l’intelligence humaine dans tous les domaines.
Combinaison d’approches symboliques (règles explicites) et statistiques (deep learning), pour allier performance et explicabilité.
Phase pendant laquelle un modèle déjà entraîné est utilisé pour faire une prédiction ou une recommandation à partir de nouvelles données.
Les informations sont le résultat de la transformation des données en quelque chose de significatif et de compréhensible, ce sont des données interprétées.
Mesure de performance utilisée en détection d’objets. Elle compare la zone d’une bounding box prédite avec la zone de vérité terrain (ground truth). Une IoU proche de 1 indique une excellente détection.
Cycle complet d’un processus d’apprentissage ou d’optimisation (ex. un passage complet sur l’ensemble des données d’entraînement). Plusieurs itérations sont nécessaires pour converger vers un bon modèle.
Unité linguistique (mot ou sous-partie) traitée par un LLM lors de la génération ou l’analyse.
Temps nécessaire entre l’envoi d’une requête à un modèle et la réception de sa réponse. En IA, faible latence = réponse rapide, très important en temps réel (voiture autonome, assistants vocaux…).
Niveau d’un réseau de neurones où s’effectuent des calculs. Les modèles IA sont empilés en couches successives, chaque couche apprenant des représentations de plus en plus complexes.
Modèle entraîné sur d’énormes corpus textuels pour générer ou comprendre du langage naturel à grande échelle.
Méthode permettant d'adapter un modèle d'IA, notamment les modèles de diffusion, à des tâches plus spécifiques sans avoir besoin de réentraîner l'ensemble du modèle
Sous-domaine de l’IA où les systèmes apprennent automatiquement à partir des données, sans être explicitement programmés. On distingue l’apprentissage supervisé, non supervisé, et par renforcement.
Norme qui permet aux grands modèles de langage (LLM) de se connecter de manière sécurisée et bidirectionnelle à diverses sources de données et outils externes.
Structure algorithmique dotée de paramètres (poids) apprise à partir de données pour accomplir une tâche spécifique.
Algorithme qui prédit l’appartenance d’un exemple à une classe (ex. classifier un email comme spam ou non).
Algorithme capable de générer de nouvelles données similaires aux données d’entraînement.
Modèle pré-entraîné sur d’énormes volumes de données avec capacité générale adaptable à de nombreuses tâches.
Modèle initialement entraîné sur un grand corpus, puis affiné sur une tâche spécifique (fine tuning).
Méthode utilisée pour retrouver, dans une base de données, les éléments les plus similaires à un point donné.
Déploiement d’un système (modèle IA, base de données…) sur l’infrastructure informatique locale d’une entreprise, plutôt que sur le cloud. Avantage : contrôle et confidentialité. Inconvénient : coûts d’entretien.
Ensemble de données libres d’accès, pouvant être utilisées, modifiées et redistribuées par tous. Les gouvernements, institutions publiques, universités ou entreprises publient ces données pour favoriser la recherche, la transparence, et l’innovation.
Donnée qui diffère significativement du reste de l’échantillon. Les outliers peuvent fausser l’apprentissage si non traités. Ex : un revenu de 1 million € dans un jeu de données de salaires typiques.
Quand un modèle apprend trop les détails du jeu d’entraînement au détriment de sa capacité à généraliser à de nouvelles données.
Chaîne d’étapes de traitement des données : collecte, nettoyage, transformation, stockage, partage.
Paramètres du modèle appris durant l’entraînement, représentant l’impact de chaque connexion entre neurones.
Injection de données malveillantes dans le jeu d’entraînement pour manipuler le comportement du modèle.
Commande textuelle donnée à un modèle génératif pour générer du contenu contextuel (texte, image…).
Technique combinant recherche documentaire et génération : un modèle LLM va chercher l’info dans une base de données externe (ou documents) avant de répondre, augmentant ainsi la précision et la fraîcheur.
Algorithme d’apprentissage automatique supervisé, composé de plusieurs arbres de décision (d’où la métaphore de la forêt).
Renforcement combiné avec retours humains pour corriger et guider l’apprentissage, utilisé dans les LLMs modernes.
Variante du RAG où le système de génération est encore plus profondément guidé par les documents récupérés, parfois jusqu’au niveau de chaque mot. Cela permet des réponses très ancrées dans la source.
Tâche de découpage d’image où chaque pixel est classifié. Elle permet de distinguer finement les objets et leurs contours. Exemple : distinguer chaque cellule dans une image microscopique.
Utilisation d’outils d’IA sans supervision IT officielle, avec risques de sécurité et gouvernance.
Hypothétique moment où l’IA dépasserait l’intelligence humaine dans tous les domaines et amorcerait une croissance auto-accélérée incontrôlable. Sujet de débats scientifiques et éthiques.
Modèle de langage de taille plus réduite que les LLMs, souvent déployé localement (edge, on-premise). Avantage : rapidité, confidentialité, coût. Exemple : LLaMA-2-7B.
Contenu de mauvaise qualité généré automatiquement, sans contrôle éditorial, inondant le web.
Dans le contexte de l’IA, une tâche désigne le problème spécifique que l’on cherche à résoudre avec un modèle.
Test de capacités conversationnelles proposé par Alan Turing pour déterminer si une machine imite humainement l’intelligence.
Architecture de réseau neuronal à base d’attention utilisée pour les LLMs et modèles génératifs.
Machine apprend des structures dans des données non étiquetées, par exemple avec clustering ou PCA.
Voir sous Computer Vision ci‑dessus.
Modèle multimodal capable de traiter à la fois du texte et des images. Il peut par exemple répondre à des questions sur une image, générer des légendes ou traduire des éléments visuels en mots.
Capacité d’un modèle à effectuer une tâche sans avoir vu aucun exemple spécifique au préalable.